Les accusations de « comportements inappropriés » de Trump contre les femmes sont bien connues, et loin d’être derrière lui. Une partie des femmes américaines s’étaient mobilisées contre lui pendant la campagne. Mais à l’heure où la loi fiscale des Républicains est en train d’être votée, et sans doute acceptée dans ses grandes lignes, il apparaît que le président poursuit des pratiques de maltraitance des femmes dans un autre domaine : celui de l’économie. Les recherches de Mariko Chang sur les inégalités de patrimoine entre hommes et femmes valent la peine d’être regardées de près, en ce qu’elles montrent la façon dont non seulement l’organisation du travail mais aussi la politique fiscale et la faiblesse des prestations sociales contribuent à ce que les femmes soient moins riches que les hommes.
Les inégalités de revenu sont importantes aux USA : pour un dollar gagné par un homme, une femme ne gagne que 77,8 cents. Mais l’écart est encore plus spectaculaire pour le patrimoine. Il est très difficile de distinguer les richesses individuelles au sein des couples car les statistiques sont essentiellement établies pour les foyer et ce n’est que par approximation que l’on peut déduire les patrimoines réciproques de l’homme et de la femme dans les couples, même si Chang consacre un chapitre à montrer les arrangements, et la façon dont les hommes ont tendance à prendre en charge les grandes décisions. C’est pour cette raison que l’essentiel des chiffres fournis dans l’ouvrage concernent les personnes non mariées. Et l’écart entre homme et femme est faramineux : les femmes célibataires possèdent 36 % de la richesse des hommes célibataires (pour le dire autrement, quand les hommes ont 1 dollar, les femmes ont 36 cents). Ces écarts sont vrais à tout âge, en proportion ils diminuent avec l’âge, mais augmentent en valeur absolue. Et plus le revenu est élevé, plus la différence est forte en valeur absolue : lorsque les personnes gagnent moins de 20 000 dollars par an, la différence est de 240 dollars, lorsqu’elles gagnent plus de 80 000, elle est de 210 000 dollars.

Comment l’expliquer ? D’abord par les différences de revenu : même si les femmes remontent la pente de ce côté-là, en particulier les femmes de moins de 25 ans, qui gagnent 95 % du salaire des hommes, l’écart reste, ce qui signifie que les hommes ont un surplus qu’ils peuvent faire fructifier. Toutefois, cette explication trouve sa limite dans le fait qu’à revenu égal, le patrimoine masculin se constitue plus vite que celui des femmes. Un facteur essentiel, qui revient de nombreuses fois dans le livre est le fait que les femmes sont mères, et que parmi ces femmes célibataires, nombreuses sont celles qui ont des enfants à charge, ce qui réduit d’autant leurs marges pour constituer un patrimoine. Mais là où les données étudiées par Chang sont les plus originales est qu’elle regarde la structure des revenus, pour expliquer pourquoi les hommes prennent ce qu’elle appelle le « wealth elevator », quand les femmes prennent l’escalier.
Pour la sociologie de l’argent, une telle approche est très importante, car si à la suite de Zelizer de nombreux travaux ont montré l’intrication de l’argent et de la famille, il s’agit ici de réfléchir à la dimension politique et sociale de la question. Comment dans le marché du travail, dans les politiques fiscales, dans la redistribution, l’organisation et les conceptions de la famille, produisent-elles des différences économiques ?
Trois domaines sont essentiels. D’abord celui des « fringe benefits », terme que les Américains utilisent beaucoup et qui est difficilement traduisible en Français et qui désigne les surplus au salaire versés à la discrétion des employeurs (charge sociale recouvre mal le terme, car les fringe benefits n’ont rien d’obligatoire et ne sont pas versés à l’Etat). Cela comprend les assurances santé et les versements sur les fonds de pension mais aussi par exemple la possibilité de prendre des jours de congé pour enfants malade. Tous les secteurs d’emploi ne sont pas aussi généreux, en particulier l’industrie (plus masculine), avec ses syndicats, offre de meilleures conditions. En outre, les employés à temps partiel sont souvent exclus de ces conventions. Les femmes étant plus souvent, en particulier pour les enfants, dans cette situation, elles se trouvent défavorisées de ce côté là, ce qui a des effets sur leur richesse à court et à long terme. Le deuxième domaine, qui pousse dans la même direction que le premier, est celui des déductions fiscales. L’Etat américain offre de généreuses déductions à deux catégories de dépenses : les intérêts d’emprunt immobilier et les versements sur les plans de retraite. Les hommes en sont davantage bénéficiaires. Pour les emprunts immobiliers, cela s’explique de deux façons : d’abord les hommes ont des maisons plus grandes, des emprunts plus chers, donc plus d’intérêts à déduire. Ensuite les hommes ont de meilleurs revenus, donc bénéficient plus des déductions. Christopher Howard, dans The Hidden Welfare State a calculé qu’en 1995, l’Etat américain a dépensé 69,4 milliards en subventions pour les pensions
outre, les employés à temps partiel sont souvent exclus de ces conventions. Les femmes étant plus souvent, en particulier pour les enfants, dans cette situation, elles se trouvent défavorisées de ce côté là, ce qui a des effets sur leur richesse à court et à long terme. Le deuxième domaine, qui pousse dans la même direction que le premier, est celui des déductions fiscales. L’Etat américain offre de généreuses déductions à deux catégories de dépenses : les intérêts d’emprunt immobilier et les versements sur les plans de retraite. Les hommes en sont davantage bénéficiaires. Pour les emprunts immobiliers, cela s’explique de deux façons : d’abord les hommes ont des maisons plus grandes, des emprunts plus chers, donc plus d’intérêts à déduire. Ensuite les hommes ont de meilleurs revenus, donc bénéficient plus des déductions. Christopher Howard, dans The Hidden Welfare State a calculé qu’en 1995, l’Etat américain a dépensé 69,4 milliards en subventions pour les pensions  plans et 53,5 pour les intérêts d’emprunts immobiliers, contre 26,6 milliards pour les food stamps et 17,3 pour les familles avec enfants. En moyenne les hommes bénéficient davantage des deux premiers et les femmes des deux seconds. Enfin, le troisième domaine où se creuse l’écart est celui des prestations sociales. Elles existent aux USA contrairement à ce que l’on peut croire parfois, il y a notamment une retraite de la sécurité sociale, qui nécessite d’avoir 35 années pleines, et des assurances chômages. Là encore, davantage d’emplois à temps partiel et les arrêts pour les maternités désavantagent les femmes.
plans et 53,5 pour les intérêts d’emprunts immobiliers, contre 26,6 milliards pour les food stamps et 17,3 pour les familles avec enfants. En moyenne les hommes bénéficient davantage des deux premiers et les femmes des deux seconds. Enfin, le troisième domaine où se creuse l’écart est celui des prestations sociales. Elles existent aux USA contrairement à ce que l’on peut croire parfois, il y a notamment une retraite de la sécurité sociale, qui nécessite d’avoir 35 années pleines, et des assurances chômages. Là encore, davantage d’emplois à temps partiel et les arrêts pour les maternités désavantagent les femmes.
L’auteur regarde aussi du côté des dettes : l’endettement américain a explosé ces dernières décennies, mais il y a dettes et dettes. Les dettes d’emprunt immobilier construisent un patrimoine, à situation économique égale toutefois, les femmes ont des crédits plus chers, elles ont 32% de chances de plus que les hommes d’avoir un crédit immobilier subprime, et les chiffres s’envolent si l’on observe les crédits reçus par les femmes noires ou hispaniques. Quant aux dettes de consommation, et particulièrement celles prisent sur les cartes de crédit, elles sont très chères et appauvrissent le foyer plutôt qu’elles ne constituent un investissement. Les femmes en souscrivent davantage. Et là c’est moins de richesse qu’il est question que de pauvreté, car, c’est une évidence, si les femmes sont moins riches, elles sont plus souvent pauvres, ce que Chang appelle “wealth poor”, c’est-à-dire sans aucun patrimoine ou avec des dettes supérieures aux possessions.
Enfin, le livre décrit la « motherhood wealth tax », et montre que les femmes perdent de l’argent quand elles deviennent mères, qu’elles quittent le marché du travail ou y restent. Si elles y restent, l’écart avec les salaires des hommes augmente de 4 % au premier enfant, de 12 % pour chacun des suivants, alors que les hommes voient au contraire un « bonus » de 9 % en moyenne pour la naissance d’un enfant. Cela s’expliquerait par les stéréotypes selon lesquelles une mère ne peut se consacrer pleinement à son travail quant un père au contraire, devant faire vivre sa famille, sera un employé parfait. En cas de divorce, les femmes, qui pour certaines avaient arrêté de travailler, se rendent compte de leur situation économiquement défavorable. Et pour l’ensemble, l’argent accumulé sur les fonds de pension, qui sera la source des revenus à la retraite sont moins élevés que ceux des hommes.
 La France connaît des phénomènes similaires, simplement les écarts sont moins forts (l’INED estime que l’écart de patrimoine entre hommes et femmes est de 15 %, voire le tableau ci-dessus). Toutefois, comme aux USA, la conception de la famille où l’homme gagne le pain quand la femme reste à la maison, infuse les politiques économiques et sociales. Ou plutôt, comme aux USA, des politiques qui ne sont pas pensées comme liées au genre (des politiques qui défiscalisent tel investissement ou établissent des montants de transferts sociaux), le sont en réalité du fait d’une plus grande pauvreté des femmes, qui ont de plus faibles revenus du travail et plus de charges d’enfants. Les retraites des femmes sont plus faibles, pour les mêmes raisons qu’aux USA : moins d’années de cotisations, des interruptions pour les enfants, et un niveau général de cotisation plus faibles. Le seul domaine qui est moins spectaculairement défavorable est celui de l’assurance santé, mais il faudrait voir en détail ce qu’il en est. Des comparaisons terme à terme seraient intéressantes pour comprendre quels mécanismes font que l’écart est plus faible en France, on peut notamment penser à l’inégalité extrême que constitue l’accès ou non aux fringe benefits. Ne pas en avoir aux USA signifie n’avoir aucun filet de sécurité en cas de problème (ne serait-ce que le droit de s’absenter pour un enfant malade), et cela a un effet considérable sur la possibilité ou non de pouvoir stabiliser sa vie et épargner.
La France connaît des phénomènes similaires, simplement les écarts sont moins forts (l’INED estime que l’écart de patrimoine entre hommes et femmes est de 15 %, voire le tableau ci-dessus). Toutefois, comme aux USA, la conception de la famille où l’homme gagne le pain quand la femme reste à la maison, infuse les politiques économiques et sociales. Ou plutôt, comme aux USA, des politiques qui ne sont pas pensées comme liées au genre (des politiques qui défiscalisent tel investissement ou établissent des montants de transferts sociaux), le sont en réalité du fait d’une plus grande pauvreté des femmes, qui ont de plus faibles revenus du travail et plus de charges d’enfants. Les retraites des femmes sont plus faibles, pour les mêmes raisons qu’aux USA : moins d’années de cotisations, des interruptions pour les enfants, et un niveau général de cotisation plus faibles. Le seul domaine qui est moins spectaculairement défavorable est celui de l’assurance santé, mais il faudrait voir en détail ce qu’il en est. Des comparaisons terme à terme seraient intéressantes pour comprendre quels mécanismes font que l’écart est plus faible en France, on peut notamment penser à l’inégalité extrême que constitue l’accès ou non aux fringe benefits. Ne pas en avoir aux USA signifie n’avoir aucun filet de sécurité en cas de problème (ne serait-ce que le droit de s’absenter pour un enfant malade), et cela a un effet considérable sur la possibilité ou non de pouvoir stabiliser sa vie et épargner.
Pour revenir à la réforme fiscale en cours, l’intérêt de la lire au prisme du genre est qu’en privilégiant ceux qui sont déjà dans la course, elle privilégie les hommes. Et privilégier les hommes, souligne Mariko Chang, c’est défavoriser les foyers féminins, où sont plus souvent élevés les enfants, c’est donc accentuer la transmission de la pauvreté.

 spécialistes, tout est enregistré, plus besoin de paperasse : les examens, radios, prescriptions sont en ligne, plutôt pratique. Et quand on a un rdv, on reçoit un coup de fil deux jours avant pour nous le rappeler. Sur place, on n’attend pas trop. Bref ça tourne.
spécialistes, tout est enregistré, plus besoin de paperasse : les examens, radios, prescriptions sont en ligne, plutôt pratique. Et quand on a un rdv, on reçoit un coup de fil deux jours avant pour nous le rappeler. Sur place, on n’attend pas trop. Bref ça tourne. apparemment habituelle dans la médecine américaine : le patient est pris en charge par une assistante, qui fait faire tous les examens. Quand tout est prêt, le médecin vient pendant une minute (et encore les fois où il traîne, c’est plutôt 30 secondes), dit « no need for surgery » et demande à revoir le patient la semaine suivante. Faut-il préciser que le médecin est le seul homme que l’on rencontre – en dehors du technicien de la radio ?
apparemment habituelle dans la médecine américaine : le patient est pris en charge par une assistante, qui fait faire tous les examens. Quand tout est prêt, le médecin vient pendant une minute (et encore les fois où il traîne, c’est plutôt 30 secondes), dit « no need for surgery » et demande à revoir le patient la semaine suivante. Faut-il préciser que le médecin est le seul homme que l’on rencontre – en dehors du technicien de la radio ?
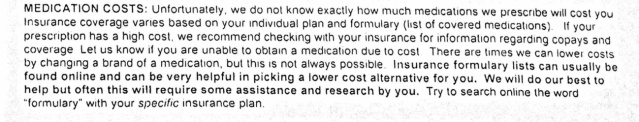


 Il faut d’abord noter que toutes les personnes avec qui nous avions été en contact par mail étaient extrêmement accueillantes. Nous avions fait l’enregistrement en ligne selon leurs conseils, et l’inscription définitive semblait une formalité. Or, en arrivant, il nous manquait deux choses : le formulaire médical devant être rempli par un médecin ayant vérifié leur condition physique (pour les yeux et les dents, on pourra attendre un peu), et deux justificatifs d’adresse. Nous n’en avions qu’un, de notre logement.
Il faut d’abord noter que toutes les personnes avec qui nous avions été en contact par mail étaient extrêmement accueillantes. Nous avions fait l’enregistrement en ligne selon leurs conseils, et l’inscription définitive semblait une formalité. Or, en arrivant, il nous manquait deux choses : le formulaire médical devant être rempli par un médecin ayant vérifié leur condition physique (pour les yeux et les dents, on pourra attendre un peu), et deux justificatifs d’adresse. Nous n’en avions qu’un, de notre logement. d’université, nous changeons d’assurance, nous n’avions rien sur nous, et l’expérience de la précédente dont il a été impossible d’avoir les informations. On a commencé à avoir des sueurs froides, car ce document médical est obligatoire pour commencer l’école. Je ne fais pas durer le suspens plus longtemps : nous nous sommes rappelés que nous avons une amie pédiatre à Evanston, qui était miraculeusement chez elle, et nous a sauvés en remplissant le papier à partir du carnet de santé des enfants (il s’agissait en gros de certifier qu’ils étaient vaccinés).
d’université, nous changeons d’assurance, nous n’avions rien sur nous, et l’expérience de la précédente dont il a été impossible d’avoir les informations. On a commencé à avoir des sueurs froides, car ce document médical est obligatoire pour commencer l’école. Je ne fais pas durer le suspens plus longtemps : nous nous sommes rappelés que nous avons une amie pédiatre à Evanston, qui était miraculeusement chez elle, et nous a sauvés en remplissant le papier à partir du carnet de santé des enfants (il s’agissait en gros de certifier qu’ils étaient vaccinés).
 intéressée à la façon dont la justice établit les liens entre les personnes en se basant sur leurs relations économiques. Le versement des indemnités après le 11 septembre l’a passionnée : l’Etat américain a accordé des sommes très élevés aux familles des victimes. Lorsque les personnes étaient mariées, avaient des enfants, les bénéficiaires étaient faciles à définir, mais il y eu des contestations lorsque les personnes vivaient en concubinage. Elle raconte ainsi le cas d’une femme qui vivait avec une autre femme. Ses frères et sœurs, afin de toucher l’indemnité, ont affirmé que cette autre femme était sa colocataire, et n’avait donc pas de lien d’intimité avec la victime. La conjointe a alors produit des preuves du lien amoureux avec celle qui n’était pas juste une colocataire : compte bancaire commun, inscription commune au club de gym, factures en tout genre.
intéressée à la façon dont la justice établit les liens entre les personnes en se basant sur leurs relations économiques. Le versement des indemnités après le 11 septembre l’a passionnée : l’Etat américain a accordé des sommes très élevés aux familles des victimes. Lorsque les personnes étaient mariées, avaient des enfants, les bénéficiaires étaient faciles à définir, mais il y eu des contestations lorsque les personnes vivaient en concubinage. Elle raconte ainsi le cas d’une femme qui vivait avec une autre femme. Ses frères et sœurs, afin de toucher l’indemnité, ont affirmé que cette autre femme était sa colocataire, et n’avait donc pas de lien d’intimité avec la victime. La conjointe a alors produit des preuves du lien amoureux avec celle qui n’était pas juste une colocataire : compte bancaire commun, inscription commune au club de gym, factures en tout genre.
 Ils me disent qu’ils sont Américains, donc qu’ils veulent bien qu’on en parle… Soulignant que les tabous autour de l’argent ne sont pas les mêmes d’un pays à l’autre. Ce n’est pas qu’il n’y en a pas ici, mais pas autour de ce sujet. Donc, nous disent-ils, ils ont choisi de financer entièrement leur fille, ne lui demandant par exemple pas de travailler l’été ou pendant son année scolaire pour participer. Certains de leurs amis font d’autres choix, par exemple, quand les enfants sont au lycée, ils leur demandent de trouver des petits jobs afin d’économiser pour payer non les frais d’inscription mais le “room and board”, c’est-à-dire le gite et le couvert sur les campus. Celui-ci peut-être très élevé, de l’ordre de 10 000 dollars par an. En échange, les facs rivalisent d’imagination pour attirer les étudiants avec des campus plus beaux les uns que les autres et des lieux de restauration faits pour que les parents et les enfants lorsqu’ils font le tour des campus avant de choisir, se pâment devant l’offre. En ce moment les sushis bars font fureur – j’ai d’ailleurs appris par un étudiant d’ici, professeur de français dans un lycée privée près de Boston, dont les tarifs dépassent les 60 000 dollars par an, que là-bas aussi les su
Ils me disent qu’ils sont Américains, donc qu’ils veulent bien qu’on en parle… Soulignant que les tabous autour de l’argent ne sont pas les mêmes d’un pays à l’autre. Ce n’est pas qu’il n’y en a pas ici, mais pas autour de ce sujet. Donc, nous disent-ils, ils ont choisi de financer entièrement leur fille, ne lui demandant par exemple pas de travailler l’été ou pendant son année scolaire pour participer. Certains de leurs amis font d’autres choix, par exemple, quand les enfants sont au lycée, ils leur demandent de trouver des petits jobs afin d’économiser pour payer non les frais d’inscription mais le “room and board”, c’est-à-dire le gite et le couvert sur les campus. Celui-ci peut-être très élevé, de l’ordre de 10 000 dollars par an. En échange, les facs rivalisent d’imagination pour attirer les étudiants avec des campus plus beaux les uns que les autres et des lieux de restauration faits pour que les parents et les enfants lorsqu’ils font le tour des campus avant de choisir, se pâment devant l’offre. En ce moment les sushis bars font fureur – j’ai d’ailleurs appris par un étudiant d’ici, professeur de français dans un lycée privée près de Boston, dont les tarifs dépassent les 60 000 dollars par an, que là-bas aussi les su shis étaient à volonté. Cela pour dire que demander à ses enfants de financer le room and board signifie qu’ils devront trouver 1000 dollars par mois s’ils ne les ont pas économisé avant. Nos amis ont préféré laissé ce temps à leur fille pour travailler, et nous disent-ils, elle remplit sa part du contrat car elle a d’excellents résultats.
shis étaient à volonté. Cela pour dire que demander à ses enfants de financer le room and board signifie qu’ils devront trouver 1000 dollars par mois s’ils ne les ont pas économisé avant. Nos amis ont préféré laissé ce temps à leur fille pour travailler, et nous disent-ils, elle remplit sa part du contrat car elle a d’excellents résultats.


 travers un accès de tous à la consommation. Voir par exemple sur le sujet A Consumers’ Republic de Lizabeth Cohen. Pour le dire très vite, si en France les catégories sociales se définissent surtout par la place dans la structure de la production, aux Etats-Unis le niveau social se définit également par la place dans la structure de consommation.
travers un accès de tous à la consommation. Voir par exemple sur le sujet A Consumers’ Republic de Lizabeth Cohen. Pour le dire très vite, si en France les catégories sociales se définissent surtout par la place dans la structure de la production, aux Etats-Unis le niveau social se définit également par la place dans la structure de consommation.




 L’assurance santé aux Etats-Unis fait partie des sujets chauds. Tandis que les sénateurs républicains n’arrivent pas à s’entendre pour détruire l’Obamacare entre ceux qui trouvent que le projet de Trump est trop timide et ceux qui estiment que finalement certains Américains se trouvent mieux avec une assurance santé que sans, je fais l’expérience d’avoir besoin d’utiliser le service de santé sans être assurée. Enfin, pas tout à fait, j’ai bien une carte d’assurée, et je crois aussi que beaucoup d’argent a été dépensé pour ça. Toutefois, de façon mystérieuse, cette assurance semble ne rien couvrir. Et le pire est que je n’arrive pas à avoir l’information, car il y a bien un site internet mais les identifiants ne fonctionnent pas. Les collègues habitués m’expliquent que l’assurance ne couvre que des accidents du travail. Mais… je ne travaille pas ici, donc ça doit être différent. Le service médical du campus me dit que n’étant pas étudiante ils ne peuvent me prendre en charge. Mais… sur ma carte d’assurée il y a écrit « student ». Et en appelant l’assurance, une dame très gentille m’explique qu’il faut qu’elle se renseigne auprès du customer service, et me rappellera. Ce qui est dommage c’est que les services médicaux coûtent en général plus cher si l’on n’est pas assuré que ce qui serait facturé à une assurance, ces dernières négociant les tarifs, ce que les individus ne peuvent faire.
L’assurance santé aux Etats-Unis fait partie des sujets chauds. Tandis que les sénateurs républicains n’arrivent pas à s’entendre pour détruire l’Obamacare entre ceux qui trouvent que le projet de Trump est trop timide et ceux qui estiment que finalement certains Américains se trouvent mieux avec une assurance santé que sans, je fais l’expérience d’avoir besoin d’utiliser le service de santé sans être assurée. Enfin, pas tout à fait, j’ai bien une carte d’assurée, et je crois aussi que beaucoup d’argent a été dépensé pour ça. Toutefois, de façon mystérieuse, cette assurance semble ne rien couvrir. Et le pire est que je n’arrive pas à avoir l’information, car il y a bien un site internet mais les identifiants ne fonctionnent pas. Les collègues habitués m’expliquent que l’assurance ne couvre que des accidents du travail. Mais… je ne travaille pas ici, donc ça doit être différent. Le service médical du campus me dit que n’étant pas étudiante ils ne peuvent me prendre en charge. Mais… sur ma carte d’assurée il y a écrit « student ». Et en appelant l’assurance, une dame très gentille m’explique qu’il faut qu’elle se renseigne auprès du customer service, et me rappellera. Ce qui est dommage c’est que les services médicaux coûtent en général plus cher si l’on n’est pas assuré que ce qui serait facturé à une assurance, ces dernières négociant les tarifs, ce que les individus ne peuvent faire.
 Le second sujet qui m’intéresse concernant l’assurance santé est son importance dans les recherches actuelles sur la “financiarisation de la vie quotidienne”, très fécondes en particulier en Amérique du Nord et en Angleterre. Ces travaux montrent la façon dont la vie des ménages est transformée par la financiarisation de l’économie, qui s’insinue dans les budgets familiaux et les modes de vie. L’Américain Jacob Hacker parle de “risk shift” pour désigner le fait que les risques auparavant pris en charge par des assurances collectives (la vieillesse, l’éducation, la famille, et tout de même un peu la santé) pèsent désormais entièrement sur les épaules des ménages qui doivent fair
Le second sujet qui m’intéresse concernant l’assurance santé est son importance dans les recherches actuelles sur la “financiarisation de la vie quotidienne”, très fécondes en particulier en Amérique du Nord et en Angleterre. Ces travaux montrent la façon dont la vie des ménages est transformée par la financiarisation de l’économie, qui s’insinue dans les budgets familiaux et les modes de vie. L’Américain Jacob Hacker parle de “risk shift” pour désigner le fait que les risques auparavant pris en charge par des assurances collectives (la vieillesse, l’éducation, la famille, et tout de même un peu la santé) pèsent désormais entièrement sur les épaules des ménages qui doivent fair e des calculs savants pour emprunter et investir leur argent pour faire face à leur futur retraite, aux études de leurs enfants, à la maladie, mais aussi pour financer leur vie quotidienne avec des systèmes d’emprunt compliqués (les subprimes l’ont bien montré) et une multiplicité de produits financiers disponibles. En Grande-Bretagne, ce sont des social scientists venus de la géographie (en particulier Andrew Leyshon, Nigel Thrift, Paul Langley, Shaun French, Thomas Wainwright, et bien d’autres) qui ont développé l’idée de la constitution d’un financial subject. Ils veulent dire par là que cette fréquentation accrue des produits financiers et l’importance de leur maniement pour assurer la continuité de la vie transforment la subjectivité des individus qui se mettent à penser comme des investisseurs boursiers. Et l’assurance santé est dans tous les cas l’un des sujets majeurs, tant les coûts pour les familles peuvent être élevés, ou bien pour la payer, ou bien pour payer les soins en son absence, ou pour les deux, quand l’assurance couvre mal.
e des calculs savants pour emprunter et investir leur argent pour faire face à leur futur retraite, aux études de leurs enfants, à la maladie, mais aussi pour financer leur vie quotidienne avec des systèmes d’emprunt compliqués (les subprimes l’ont bien montré) et une multiplicité de produits financiers disponibles. En Grande-Bretagne, ce sont des social scientists venus de la géographie (en particulier Andrew Leyshon, Nigel Thrift, Paul Langley, Shaun French, Thomas Wainwright, et bien d’autres) qui ont développé l’idée de la constitution d’un financial subject. Ils veulent dire par là que cette fréquentation accrue des produits financiers et l’importance de leur maniement pour assurer la continuité de la vie transforment la subjectivité des individus qui se mettent à penser comme des investisseurs boursiers. Et l’assurance santé est dans tous les cas l’un des sujets majeurs, tant les coûts pour les familles peuvent être élevés, ou bien pour la payer, ou bien pour payer les soins en son absence, ou pour les deux, quand l’assurance couvre mal.